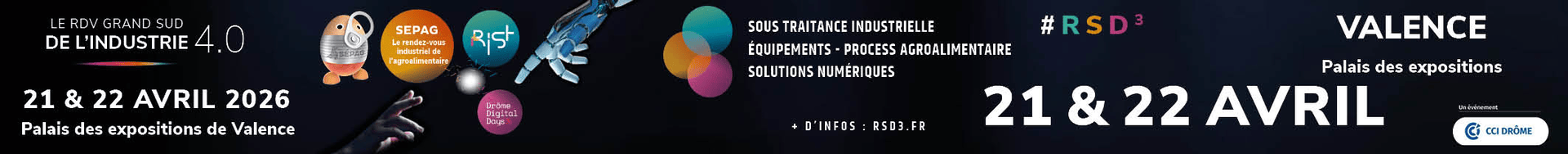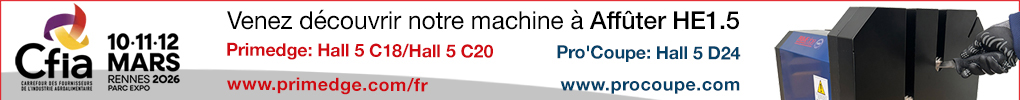Biomatériaux : une lente transition s’opère
publié le mercredi 30 avril 2025
Abonnez-vous à la revue pour lire la suite de l'article
s'abonner
La production de biomatériaux continuera de croître ces prochaines années. Des investissements industriels majeurs portent l’augmentation des quantités et la fabrication à l’échelle industrielle de bioplastiques encore peu exploités. Mais cet élan pourrait se heurter à la réglementation encore floue concernant les bioplastiques.
Ces dernières années, les capacités de production mondiale des bioplastiques n’ont cessé de croître, portées par des investissements significatifs et une demande croissante pour des alternatives durables aux plastiques d’origine fossile. Elles devraient doubler ces prochaines années, passant de 2,47 millions de tonnes en 2024 (dont environ 1,4 million de bioplastiques biodégradables) à environ 5,73 millions de tonnes en 2029. Sur cette capacité de 2,47 millions, 56% sont donc des biopolymères biodégradables, dont 37% de PLA. D’ici 2029, la part des bioplastiques biodégradables devrait atteindre 66% (dont 42% de PLA et 17% de PHA, dont la croissance est fulgurante). Quant aux bioplastiques non-biodégradables, ils totalisaient 43% des capacités en 2024, dont 14% pour le PA (polyamides), 13% pour le PTT (polytéréphtalate de triméthylène, surtout pour l’industrie textile), 11% pour le PE et 2,7% pour le PET. Le PP n’occupe que 0,6%, mais d’ici 2029, il devrait atteindre 8,5%. «La plupart des producteurs de biomatériaux ont implanté leurs usines en Asie, car cette région du monde offre des matières premières abondantes et soutient souvent financièrement les entreprises qui s’y installent. L’Europe reste modeste en termes de production, avec une part de marché de 13,4%. Les capacités mondiales devraient atteindre 5,7 millions de tonnes en 2029, mais la part européenne tombera à 10,4% – l’Asie connaissant également une forte croissance», explique Hasso von Pogrell, directeur général de l’association European Bioplastics, qui soutient la législation en faveur des bioplastiques en Europe. Actuellement, 45% des bioplastiques sont utilisés pour l’emballage : cette proportion devrait atteindre 53% en 2029.
Le choix d’un bioplastique
Pour la fabrication des emballages alimentaires (barquettes, gobelets, films, revêtements), le PLA (acide polylactique) et le PHA (polyhydroxyalcanoates) sont les matériaux biodégradables les plus en croissance. Le PHA, encore en production limitée, permet la fabrication de films alimentaires ou de revêtements pour le papier, par exemple. Autre alternative encore peu développée et biodégradable : le PBS (polybutylène succinate), un dérivé d’acide succinique, issu de la fermentation de sucres. Il peut être utilisé pour des films, barquettes ou revêtements alimentaires. Le BioPBS™ mis au point par le groupe Mitsubishi Chemical Corporation est disponible en Europe via sa filiale MCPP Europe. Les bioplastiques comme le bio-PP, le bio-PE, le bio-PET ou le PEF sont eux non-biodégradables. Ils ont l’avantage d’être proches de leurs équivalents fossiles en termes de propriétés mécaniques et fonctionnels, et peuvent être recyclés dans les filières de tri existantes. Le PEF est apte à rejoindre la filière de tri du PET. Au niveau des coûts en revanche, la plupart des bioplastiques sont plus chers que les plastiques fossiles. Si la réglementation évolue en leur faveur, il est probable que les quantités de production seront plus importantes et que les coûts diminueront… Le choix d’un bioplastique dépend évidemment de l’application à laquelle il est destiné. Des entreprises misent sur des matériaux hybrides, comme Sulapac qui a développé ses propres solutions. La société possède deux usines partenaires en Europe, disposant d’une capacité de production totale de 45 000 tonnes. Ses matériaux sont vendus à des fabricants d’emballages qui les transforment ensuite en produits Sulapac® en utilisant leurs équipements de plasturgie existants. Dans le secteur de la restauration, Sulapac a développé des matériaux spécifiques pour des applications réutilisables ou à usage unique. Le Sulapac Flow 1.7, par exemple, est un matériau thermoformable biodégradable, composé de copeaux de bois issus de sous-produits industriels et d’une combinaison de biopolymères biodégradables. Il permet de fabriquer des plateaux, des gobelets, des couvercles compostables… Concernant les emballages réutilisables, Sulapac a lancé en 2023 le matériau Sulapac Solid, pouvant être moulé par injection. Il a été amélioré depuis. Ce matériau biosourcé a notamment été utilisé dans le cadre d’un projet pilote avec Burger King, afin de fournir aux restaurants du groupe des gobelets réutilisables. Pour les applications alimentaires, Sulapac développe une nouvelle catégorie de matériaux, dont le lancement est prévu cette année.
Des investissements majeurs en Europe
Matériau peu utilisé jusqu’alors, le PEF est désormais produit à l’échelle industrielle. L’entreprise néerlandaise Avantium a inauguré en 2024 sa première usine dédiée à la production d’acide furane dicarboxylique (FDCA) à Delfzijl, aux Pays-Bas. Le FDCA est le composant principal du polyéthylène furanoate (PEF), un polymère biosourcé et recyclable similaire au PET. Il peut être utilisé pour fabriquer des bouteilles, des emballages et des textiles. Il s’agit de la première installation au monde à produire du FDCA à l’échelle commerciale. Avantium a signé un accord stratégique avec Tereos garantissant un approvisionnement à 100% en matières premières biosourcées sous forme de sirop à haute teneur en fructose, issu de blé européen. La société de chimie verte a également établi des partenariats avec des entreprises majeures pour promouvoir l’utilisation du PEF – notamment avec Amcor Rigid Packaging USA qui produira des emballages rigides pour de l’alimentaire, entre autres, à base de PEF. Amcor aura en outre un accès privilégié aux volumes de PEF produits par le réseau de futurs licenciés d’Avantium. Autre projet d’envergure : la bioraffinerie de Futerro en France. Cette entreprise belge produit actuellement 100 000 tonnes de PLA par an en Asie, ce qui la place au rang de second producteur mondial. Elle investit fortement pour produire et recycler ce matériau biosourcé en Europe avec le projet d’une bioraffinerie intégrée construite en Normandie et opérationnelle d’ici 2028. Ce site, qui représente un investissement de l’ordre de 500 millions d’euros, comprendra «une unité de production d’acide lactique, une molécule plateforme biosourcée produite à partir de matières premières agricoles françaises et durables. Notre partenaire local Tereos en extraira notamment l’amidon qui est ensuite transformé en dextrose (ou sucre) pour être fermenté. Le site disposera également d’une unité de conversion de cet acide lactique en lactide puis PLA– pour une production totale de 75 000 tonnes à terme», détaille Geoffroy Delvinquier, responsable marketing de Futerro et assistant exécutif du pdg, fondateur de l’entreprise, Frédéric Van Gansberghe. Le site abritera également une unité de recyclage chimique et mécanique de PLA.
Des freins au développement des bioplastiques
Reste que, pour l’instant, ces capacités ne sont pas exploitées à plein régime. En 2024, l’industrie des bioplastiques n’a produit qu’à hauteur de 58% de ses capacités, soit 1,44 million de tonnes sur 2,47 millions de tonnes potentielles. Les raisons sont multiples : la transition vers les bioplastiques est lente – que ce soit du côté des consommateurs ou des industriels, et les coûts de production plus élevés. A cela s’ajoutent les défis liés à l’approvisionnement en matières premières, le manque de structures de recyclage pour les bioplastiques biodégradables, ou les incertitudes réglementaires. Le règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) est entré en vigueur en février 2025. La plupart de ses dispositions seront obligatoires à partir d’août 2026. «Cette réglementation implique de nombreuses législations secondaires à venir. Concernant les bioplastiques biodégradables, la PPWR prévoit que certaines applications seront obligatoirement compostables en Europe – comme les sachets de thé, les dosettes de café ou encore les autocollants sur les fruits. Nous aurions préféré que la liste soit beaucoup plus large. De nombreuses autres applications – comme les petits sachets de ketchup, par exemple – ne sont actuellement pas recyclées et ne le seront probablement jamais, car ce n’est pas économiquement viable», souligne Hasso von Pogrell. Outre la directive PPWR, chaque Etat membre peut également décider qu’une application ou un produit particulier doit être obligatoirement compostable. «Tous les autres produits qui ne seront pas obligatoirement compostables devront prouver qu’ils peuvent être recyclés, soit mécaniquement, soit chimiquement. D’ici 2035, ils devront également être recyclés à grande échelle – mais certains marchés étant très petits, cela pourrait signifier la disparition de nombreuses applications biodégradables sur le marché, ce qui est regrettable», note Hasso von Pogrell. Concernant les bioplastiques non biodégradables, la Commission européenne fixe des objectifs en matière de contenu recyclé dans les emballages. «Notre intention est de pouvoir substituer ce contenu recyclé par des biopolymères, ou par une combinaison des deux. C’est l’une des nombreuses législations secondaires à venir qu’il faudra suivre de près… La question reste ouverte», ajoute-t-il.
Lancer la dynamique de recyclage des biomatériaux
Pour Geoffroy Delvinquier, la directive PPWR manque de clarté concernant les bioplastiques : «elle laisse planer de nombreuses incertitudes sur les évolutions à venir», constate-t-il, citant les articles 8 et 9 se rapportant aux plastiques biosourcés ou compostables. «D’ici février 2028, une étude sera menée sur les bioplastiques, mais on ignore qui va la lancer, et sur quels critères. Selon le résultat de cette étude, ces matériaux pourraient bénéficier d’objectifs d’inclusion dans les emballages, ou même substituer les obligations en termes de quantités de matière recyclée obligatoire…ou pas», remarque-t-il. L’article 9 porte lui sur les emballages compostables : d’ici un an, chaque état membre pourra désigner, au niveau national, les types de produits qui devront être compostables. Idem concernant la directive SUP, qui recommande l’interdiction des plastiques (incluant également les bioplastiques, sans distinction entre les biodégradables et les autres) tout en laissant une latitude à chaque état membre. L’Espagne et l’Italie (avec l’éco-organisme Biorepack) mettent en place des filières de compostage pour ces matériaux – ce qui est un premier pas. «Selon la PPWR, tous les emballages devront être recyclables d’ici 2030. Pour y parvenir, des critères de «conception pour le recyclage» sont en cours d’élaboration pour chaque catégorie de matériaux, y compris les biodégradables comme Sulapac. Nous croyons aux technologies de recyclage avancées, comme l’hydrolyse – un procédé à base d’eau nécessitant des températures bien plus basses et offrant des rendements bien plus élevés que le recyclage des plastiques conventionnels. Il existe un réel élan pour que les bioplastiques biodégradables deviennent totalement circulaires, et plusieurs projets financés par l’Europe œuvrent en ce sens, comme MoeBIOS, PROSPER et ReBioCycle, dont notre société fait partie», explique Laura Tirkkonen-Rajasalo, cofondatrice et directrice conformité de Sulapac.
Un recyclage chimique en boucle fermée
Dans la future bioraffinerie de Futerro, les capacités de recyclage mécanique devraient être de 2000 tonnes, et de 5000 tonnes pour le recyclage chimique, utilisant la technologie de solubilisation – dépolymérisation permettant de recycler de manière quasi-infinie les déchets à base de PLA. Avec sa technologie de recyclage chimique brevetée LOOPLA™, l’entreprise transforme par une approche en boucle fermée les déchets industriels de ses clients en acide lactique pour produire à nouveau du PLA vierge, apte au contact alimentaire. «Cela représente une petite capacité de recyclage, mais nous voulons lancer la dynamique du recyclage des biomatériaux. Nous essayons en parallèle de développer une filière post-consommation avec Citeo ou d’autres éco-organismes mais le PLA constitue encore une masse faible aujourd’hui par rapport aux matériaux d’origines pétrolifères. En France, les centres de surtri nous intéressent. Cela dit, certains pays – comme la France ou la Belgique – font payer aux metteurs sur le marché des écotaxes plus élevées pour les bioplastiques par rapport aux matériaux pétro-sourcés et malgré leur intérêt écologique indéniable… Cela n’incite pas à les choisir. En Espagne ou en Italie, le paradigme est inversé et l’usage de ces matériaux est mis en avant», assure Geoffroy Delvinquier. «En Chine, comme dans d’autres régions du monde où les législations sont favorables aux bioplastiques, des opportunités sont créées et des marchés prometteurs s’ouvrent rapidement», conclut-il. Quel virage prendra la France ? A voir dans quelques années.